21/11/2011
Robert Hoskins - Les Fracassés
Poursuivant mon exploration de ma propre bibliothèque, en quête des innombrables livres amassés durant mes années d'études et toujours pas lus, voilà que je tombe sur Les Fracassés, d'un obscur inconnu en France, Robert Hoskins, publié par le Masque-SF en 1979. Une couverture étrange, ni moche, ni belle, un titre qui étonne: voilà qui ne pouvait qu'attirer mon regard.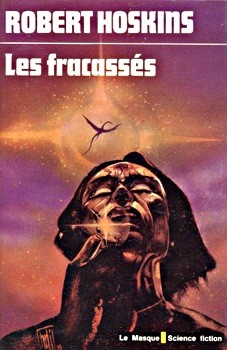
Bref, quelques heures de lecture plus tard, le bilan est positif.
Aaron est un chasseur, sur un monde sauvage. Parti à la recherche de nouveau territoires de chasse pour sa tribu, il doit échapper à de multiples dangers pour ramener un simple sac de viande à une population misérable qui crie famine.
Ducas Martin est un courtisant, le plus proche de l'impératrice Karyn, laquelle est censée régner sur un empire couvrant plusieurs systèmes stellaires, peuplés de plusieurs milliards d'habitants. Mais il doit lutter contre le Conseil, lequel relègue petit à petit les souverains au rang d'archaïsme, pour laisser tout le pouvoir à la police. Martin, lui, tente de prendre contact avc un étrange maquis, au risque de créer une alliance contre-nature entre une impératrice qui veut retrouver son pouvoir, et une résistance qui se voudrait démocratique.
Voilà un petit roman, court, mais intense. Si l'on n'est pas toujours très sûr de comprendre les intrigues de cour, les scènes de chasse (et plus généralement les scènes d'action), sont intenses et magistralement menées. On vit avec Aaron dans le désert, on lutte avec Martin. Et si le lien entre les deux intrigues est de prime abord peu évident, on finit vite par comprendre que la situation du premier est artificielle, et due à ce que vit le second.
Les Fracassés s'avère donc l'exemple type du petit roman agréable, idéal pour une après-midi tranquille. L'exemple type du roman de SF qui manque singulièrement de nos jours.
08:36 Publié dans Livre, Planète-SF | Lien permanent | Commentaires (0)
09/11/2011
Fabrice Colin -Comme des fantômes
Dieu qu'il va être dur de parler de ça.
Parce que Fabrice Colin est mort. En 2005. C'est ce qu'ils disent tout au long du bouquin. Un incendie. Et donc, tirer sur un corbillard, ça ne se fait pas.
Bref, Richard Comballot s'est chargé du recueil posthume, avec force notes, commentaires, préface et postace. Du grand art, classique dans sa forme mais efficace, faisant appel à moult témoignages de personnalité plus ou moins proches du défunt. Tout ça pour emballer quoi? Ma foi une vingtaine de textes, a priori plutôt hétéroclites: des nouvelles essentiellements, mais aussi des notes encyclopédiques et une interview sans doute apocryphe.
Vaste fatras visant juste à publier l'ensemble de ce qui pouvait traîner dans les décombres de l'appartement incendié de l'auteur? Non. Car il s'y trouve une vraie unité d'ensemble. Et le titre du recueil est porté à merveille. Car il y en a des fantômes, ici. Des vrais, des fantasmés. Fantômes de l'enfance, essentiellement: Alice, Peter Pan et les pirates du Capitaine Crochet, divers personnages de Jules Verne. Tout cela fleure bon le tournant du siècle. Pas celui du XXIe siècle, mais celui du XXe.
Alors bien sûr on pourra reprocher à Fabrice Colin - mais que peut-on reprocher à un mort - de se livrer, au travers de ces personnages en quête de leur enfance, à une psychanalyse facile - et surtout gratuite - aux dépends de ses lecteurs. Bon. Sauf que ça tombe bien: Freud, lui aussi, est du tournant de ce siècle. Le XXe. Pas de chance.
En tout cas, à la lecture de cet ensemble, on ne peut que pester contre ce regrettable incendie, qui a mis fin à la carrière d'un auteur prometteur. Car des bons textes, il y en a, et plein. En premier lieu "Naufrage mode d'emploi", où l'on peut découvrir ce que deviennent les créations inexploitées d'un auteur de fantasy. "Un dernier verre, ô dieux de l'oubli" est une merveille montrant un Dionysos toujours aussi assoiffé, en quête de sa mère sur la côte ouest des USA au milieu des années 80. "Retour aux affaires" est une belle chasse aux fantômes dans une drôle d'ambience steampunk. Je ne supporte pas le steampunk, ce genre qui permet tout juste à la SF de se regarder le nombril. Mais là, c'est autre chose. Une autre trempe. Idem avec "Intervention forcée en milieu crépusculaire". Il faut du temps pour entrer dans ce récit et comprendre que l'on a affaire à des personnages de Jules Vernes peu connus. Mais l'effort en vaut la peine.
La plume de l'auteur est belle, subtile, tout en finesse. Son propos est profond, intime, et pourtant émaillé d'humour, de dérision jamais méchante, sauf peut-être parfois avec lui-même.
On regrettera juste deux textes qui auraient pu disparaître dans les flammes sans manquer vraiment:
"Intérieur nuit", une banale histoire de vampires, dont le style tient plus du brouillon qu'autre chose (et Baba Yaga n'est pas lithuanienne, mais bon); "Passer la rivière sans toi", un texte bien troussé mais qui relève de la bluette de jeune fille en fleur, manquant de la subtilité des autres textes.
Deux sur tout cet ensemble: une paille donc.
Maintenant, il ne reste plus qu'à faire tourner les guéridons, tenter de faire revenir Fabrice Colin "chez les vivants".
PS: vous ai-je dit que la couverture de Bastien L. est juste formidable? Non? Bon, c'est fait.
14:56 Publié dans Livre, Planète-SF | Lien permanent | Commentaires (0)
20/10/2011
Walter Jon Williams - Aristoï
Tiens, un roman utopiste américain. En tout cas, c'est ce que Walter Jon Williams a déclaré vouloir faire avec Aristoï (lu ici dans son édition J'ai Lu de 1995) Ca n'est pas si banal que ça venant d'un auteur américain, et donc il me fallait y jeter un oeil. 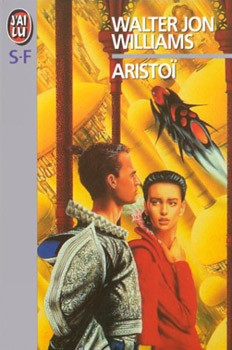
Dans un lointain futur, alors que la Terre a été détruite par une prolifération de nanos incontrôlée, une société idyllique a été mise en place afin d'éviter ce genre d'accident fâcheux : la Logarchie. Les humains y sont divisés en trois classes : les Demos - la base -, les Therapons – 'encadrement -, les Aristoï - les meilleurs, véritables demi-dieux qui contrôlent tout, chacun dans son domaine. Et l'évolution des gens d'une classe à l'autre se fait au moyen d'examens strictement contrôlés : tout fonctionne au mérite, et donc sur la base d'une justice parfaite. L'humanité, sur ce modèle, est répandu dans un vaste secteur de la galaxie, et l'ensemble est chapeauté par un réseau maintenu en place grâce à des communications instantanées utilisant les tachyons. S'il faut plusieurs mois pour se rendre d'un monde à l'autre, il est donc ainsi toutefois possible de discuter, de façon virtuelle, avec une personne située à des années lumière de là. Le monde réel se retrouve doublé d'un monde virtuel, lequel est constamment enregistré sur le réseau, ce qui permet d'éviter toute fraude, manipulation ou acte de malveillance.
Lorsqu'un therapon est jugé apte à devenir un aristo, on le dote d'un domaine, à savoir que l'on crée et terraforme plusieurs planètes que l'on ouvre alors à la colonisation par des demos volontaires, lesquels deviendront ses sujets.
Ajoutons à cela que tout le monde est connecté au réseau grâce à un implant, et que les therapons et les aristoï développent volontairement en eux une forme de schizophrénie multiple, c'est à dire l'apparition de personnalité secondaire, aptes à les aider dans les diverses tâches qui leur incombent. Ainsi un aristo pourra confier la gestion de son corps à l'un de ces « daimones » (c'est le nom donné à ces personnalités secondaires), tout en passant lui-même son temps à composer intérieurement un opéra. C'est pratique, il faut bien l'avouer, même si ça doit être soûlant finalement d'avoir tout un bureau en open space dans la tête.
Bon. Plein de (vraies) bonnes idées donc. Cela suffit-il à faire un roman ? Non.
Car durant les 200 premières pages, Williams ne fait que mettre en place son cadre. On suit Gabriel, jeune (enfin déjà centenaire, quand même) et brillant aristo. Un esthète. Mais voilà : il compose un opéra, il rencontre quelqu'un (homme ou femme), puis mange avec le quelqu'un en question (on a tout le menu), puis couche avec le quelqu'un en question (homme ou femme, tout le menu aussi - enfin moins quand il s'agit d'hommes bizarrement), puis discute avec le quelqu'un, puis rebelote, dans un ordre différent, et ceci avec tous les détails possibles. Williams a juste omis de préciser le prix des plats consommés. A vrai dire, on s'en fiche, puisqu'on sait que les aristoï ont tous les droits ou presque.
On finit par comprendre que quelqu'un a fait quelque chose de mal : créer des planètes en y implantant une humanité primitive. Et que cet aristo est prêt à tout pour garder cela secret : y compris falsifier les données du réseau, y compris tuer la personne qui a découvert la chose. Et c'est Gabriel qui va devoir enquêter. En se rendant sur l'un des mondes sauvages. On se demande bien pourquoi il ne se contente pas de dévoiler directement la chose aux autres aristoï, mais bon : il fallait bien que ça bouge un peu. Et c'est vrai. Lorsque Gabriel et son équipe de therapons se retrouve sur Terrina, ledit monde sauvage, ça bouge. Mais patatra : on se retrouve alors face à ce qui n'est ni plus ni moins qu'une redite de Il est difficile d'être un dieu, l'un des romans clés des frères Strougatski. Si si. Hommage ? Plagiat ? Peu importe au final : ce qui compte est qu'on y trouve rien de neuf. Gabriel se fait passer pour noble venu d'un lointain pays (Roumata d'Estor se fait passer pour un noble venu d'une lointaine province), sur un monde dont le niveau se place à celui de la fin de la Renaissance et du début de l'Époque moderne, il infiltre la haute société, prend un amant local (tout comme Roumata prend une amante, la différence tient dans le sexe différent de l'autochtone), se retrouve à infiltrer une prison dont on dit que personne n'en sort vivant et où il fait face à un ecclésiastique vicelard qui prend plaisir à la torture. Tout y est. Même le coup des pièces d'or trop pures. Seule différence : si pour Roumata, « il est difficile d'être un dieu », pour Gabriel, « un aristo pouvait tout faire sur cette planète » (p. 255).
Et il ne s'en prive pas. Lui qui se comportait jusqu'ici comme une oie blanche au coeur d'artichaut (il tombe amoureux toutes les cent pages), tue sans état d'âme, y compris même au sein d'une foule, à la vue de tout le monde. Car là où le roman des Strougatski est solide et bien structuré, avec un propos fort, c'est l'ensemble de cette partie d'Aristoï qui ne tient pas debout. Tout va trop vite, trop bien. Ca n'est tout simplement pas crédible.
Autrement dit, à la copie, préférez l'original.
PS : j'aurais du me douter qu'un bouquin avec en couverture David Martinon en costume à fraise façon Henri IV ne pouvait pas être bon.
13:33 Publié dans Livre, Planète-SF | Lien permanent | Commentaires (3)


